Étiquettes
Faire des guerres, gestion de la sécurité, Histoire polique, influence des éléctions, les groupes d'intérêt, les présidents américains
Comme le montre un nouveau livre, ce n’est pas toujours une question de stratégie.
Par Julian E. Zelizer, professeur d’histoire et d’affaires publiques à l’université de Princeton.
S’il est une constante dans l’histoire politique des États-Unis, c’est bien que les présidents commettent souvent des erreurs d’appréciation, de calcul, voire des fautes graves dans la gestion de la sécurité nationale. Le Viêt Nam reste le cas d’école ultime : un exemple frappant d’un politicien talentueux et couronné de succès – en l’occurrence, le président Lyndon B. Johnson – qui a envoyé sans réfléchir des centaines de milliers de militaires au combat.
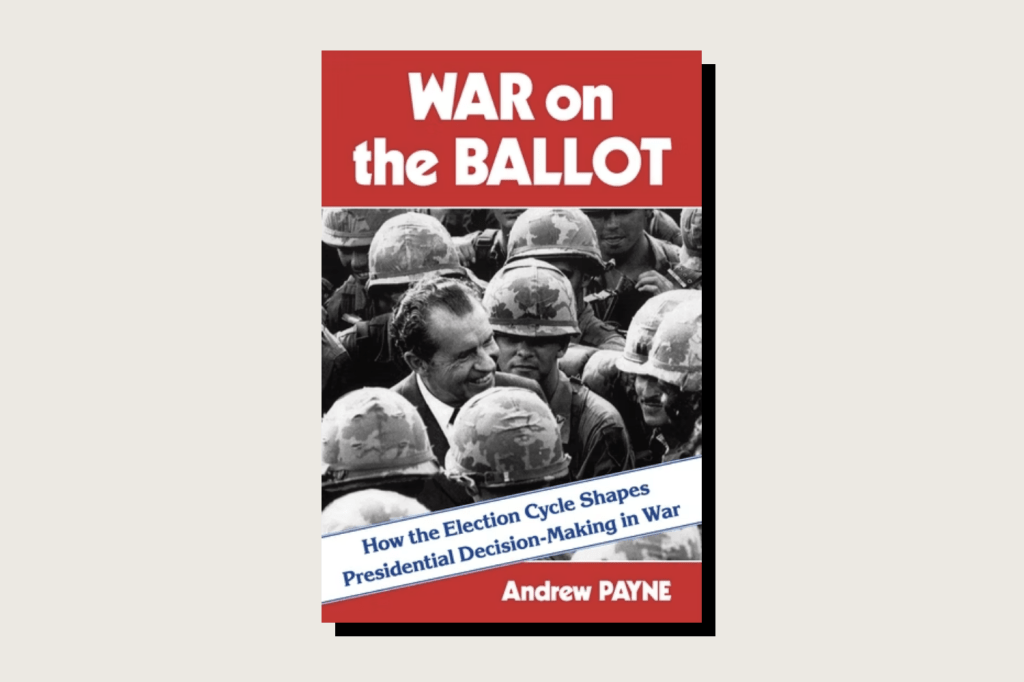
La guerre sur le bulletin de vote : How the Election Cycle Shapes Presidential Decision-Making in War, Andrew Payne, Columbia University Press, 336 p., , juillet 2023
Les historiens et les spécialistes des sciences sociales ont fait couler beaucoup d’encre pour tenter d’expliquer ce qui a conduit les présidents américains à abuser de leur pouvoir de commandant en chef. Pour de nombreuses générations d’universitaires, la réponse à la question de savoir ce qui a mal tourné au Viêt Nam et dans d’autres guerres ratées se trouve dans les orthodoxies idéologiques qui ont rendu les élus aveugles aux faits sur le terrain. Au Viêt Nam comme en Corée, les historiens soutenaient que la « théorie des dominos » était à blâmer, car elle prédisait que si un petit pays tombait dans le giron du communisme, d’autres suivraient.
Les historiens de la nouvelle gauche des années 1960 et 1970 sont parvenus à des conclusions très différentes. Dans leurs travaux, l’idéologie n’avait pas grand-chose à voir avec la guerre ; au lieu de chercher à protéger la démocratie à l’étranger, les administrations partaient en guerre pour satisfaire des groupes d’intérêt, apaiser les commissions du Congrès, alimenter les budgets des entreprises de défense ou s’assurer le contrôle de territoires et de ressources naturelles précieuses. Selon eux, à mesure que le pouvoir exécutif prenait de l’ampleur, les présidents et les responsables de la sécurité nationale se voyaient accorder trop de pouvoirs non contrôlés pour faire ce qu’ils voulaient, ce qui entraînait de mauvaises décisions en temps de guerre.
Toutefois, au cours de la dernière décennie, les universitaires ont commencé à s’éloigner de l’idéologie ou des intérêts matériels pour examiner l’importance d’un tout autre facteur : la politique électorale. Un nouvel ouvrage du politologue Andrew Payne, War on the Ballot : How the Election Cycle Shapes Presidential Decision-Making in War, est un complément bienvenu au travail de cette petite cohorte de chercheurs – dont Fredrik Logevall, Campbell Craig, Jeremi Suri et moi-même – qui ont tenté de développer une histoire de la présidence américaine dans laquelle les commandants en chef sont constamment confrontés aux implications politiques nationales de leurs décisions à l’étranger.
« C’est une vérité dérangeante, écrit Payne, rarement admise, que les dirigeants prennent habituellement en compte les considérations électorales lorsqu’ils prennent des décisions sur la stratégie militaire et diplomatique en temps de guerre. Pour chaque officier militaire ou expert du département d’État qui, dans la salle de crise, conseille le président sur la meilleure voie à suivre pour les troupes américaines, un autre conseiller met en garde contre l’impact que ces politiques pourraient avoir sur les prochaines élections.
Comme l’a candidement reconnu l’ancien président Richard Nixon, lorsqu’il s’agit de déterminer le meilleur plan d’action en temps de guerre, « gagner une élection est terriblement important ». Dans une démocratie, il est pratiquement impossible que la politique s’arrête au bord de l’eau – et malgré les bévues du passé, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

Le président de l’époque, Richard Nixon, est entouré de tableaux lors d’un discours télévisé depuis la Maison Blanche, au cours duquel il a annoncé le retrait des troupes américaines supplémentaires du Viêt Nam, sur cette photo datant de 1971.Bettmann/Getty Images Archive
Dans War on the Ballot, Payne propose une évaluation systématique de l’imbrication entre les élections et l’élaboration de la politique étrangère au cours d’une présidence. Il décrit cinq façons dont les élections américaines peuvent influer sur la prise de décision présidentielle en temps de guerre : retard (report de l’action militaire jusqu’à la tenue d’une élection) ; atténuation (dilution d’une bonne action stratégique jusqu’au vote) ; incitation (accélération de l’activité militaire pour paraître dur en matière de défense avant une élection) ; réaction (être influencé par les résultats électoraux pour rompre ou respecter les promesses de campagne en matière de guerre) et perturbation (lorsque les élections interfèrent avec les stratégies de négociation ou les perturbent).
‘ Les trois premiers, écrit Payne, ont tendance à se produire entre les élections de mi-mandat et les campagnes de réélection, et les deux derniers dans la période du duck boiteux, lorsque les présidents sont plus préoccupés par leur héritage. Il est important de noter que Payne affirme que nous devons prendre en compte les différents types de cycles électoraux : élections intermédiaires ou présidentielles, élections ou réélections, anticipation ou post-mortem, et bien d’autres choses encore.
Certains lecteurs trouveront que ces catégories sont quelque peu formulées et jargonnantes. En outre, comme toute typologie de sciences sociales, la feuille de route de Payne sur la prise de décision présidentielle est trop précise. Les présidents peuvent être contradictoires. Souvent, ils prennent des décisions de manière ad hoc, motivées par des considérations changeantes dans l’instabilité et l’imprévisibilité de la guerre plutôt que par une stratégie claire. Certaines actions entrent dans plusieurs catégories. Il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre l’intérêt national et l’intérêt politique. Le livre de Payne s’appuie sur le type de modèle d’acteur rationnel qui anime la science politique, mais qui est souvent beaucoup plus propre que la réalité.
Néanmoins, le cadre de Payne est utile pour réfléchir à la manière dont les politiques démocratiques façonnent les différents moments d’une présidence. Et c’est dans le détail que son travail brille. Il présente trois études de cas très intéressantes, s’appuyant sur des archives, des documents récemment publiés et des entretiens pour montrer que les présidents avaient l’esprit en éveil lorsqu’ils ont décidé de déployer ou non des troupes en Corée, au Viêt Nam et en Irak, et de quelle manière. Dans chaque cas, l’intérêt électoral l’a emporté sur l’intérêt stratégique national.

Un homme vend des journaux, montrant la première page annonçant l’intervention militaire américaine en Corée, à Paris le 28 juin 1950. AFP via Getty Images
Nous apprenons, par exemple, que le président Harry Truman a permis aux faucons de Washington d’accélérer l’engagement du pays en Corée par crainte de paraître faible à l’approche des élections de mi-mandat de 1950. Les élections de 1952 ont également poussé le candidat républicain à la présidence, Dwight D. Eisenhower, à adopter une position de plus en plus agressive à l’égard de la Corée, alors qu’il cherchait à apaiser les anticommunistes purs et durs de son parti – bien qu’il soit intentionnellement resté suffisamment vague pour se laisser la possibilité de changer de cap dès son entrée en fonction. Après avoir remporté la présidence, Eisenhower a cherché à obtenir un armistice en dépit de sa rhétorique de campagne.
Le chapitre sur le Viêt Nam montre comment Johnson s’est abstenu d’appliquer la théorie des dominos et d' »américaniser » la guerre avec des troupes américaines jusqu’à l’élection de 1964, à l’exception notable de la demande de résolution du golfe du Tonkin en août 1964, après qu’une attaque présumée l’ait encouragé à agir avec fermeté. Johnson a ensuite intensifié l’engagement des États-Unis après avoir remporté une victoire écrasante sur le sénateur Barry Goldwater. Libéré des préoccupations électorales, Johnson aurait pu décider de se retirer ou de poursuivre la neutralisation, comme le vice-président Hubert Humphrey l’y invitait, mais il a préféré conclure que l’escalade était essentielle pour préserver sa coalition législative. Les efforts qu’il a déployés pour parvenir à une paix pendant la période de vacance du pouvoir, après avoir décidé de ne pas se représenter, ont été compromis par le cycle électoral de 1968, en particulier par les efforts infâmes déployés par la campagne du candidat à la présidence de l’époque, Richard Nixon, pour faire échouer les négociations.

Le président de l’époque, George W. Bush, s’exprime depuis la Maison Blanche à Washington, D.C., pour annoncer que l’armée américaine a frappé des « cibles d’opportunité » en Irak, le 19 mars 2003. Alex Wong/Getty Images
Plusieurs décennies plus tard, le président George W. Bush a résisté à l’idée d’augmenter la présence des troupes américaines en Irak jusqu’à la fin des élections de mi-mandat de 2006, de peur d’influencer les électeurs ; dans ses mémoires, il a admis qu’il avait attendu pour que sa décision ne paraisse pas politique. Il n’a pas non plus renvoyé le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld avant les élections de mi-mandat. Deux ans plus tard, lorsque Barack Obama s’est présenté à l’élection présidentielle, il a promis de retirer les troupes d’Irak, mais il a ralenti le rythme après avoir remporté l’élection et fait face à ses propres craintes concernant les élections de mi-mandat. Il a ensuite accéléré le retrait des troupes à l’approche de sa campagne de réélection, comprenant que de nombreux démocrates évalueraient s’il avait respecté son engagement.
Le livre de Payne comporte des erreurs et des occasions manquées. Par exemple, Payne définit les considérations politiques comme étant principalement liées aux élections, par opposition à l’adoption de lois et à la préservation des coalitions au sein du Congrès, qui sont essentielles à la protection des politiques intérieures et de sécurité nationale. Et bien que Payne démontre comment les ambitions politiques ont influencé la résistance de Johnson au retrait des troupes en 1965, il ne consacre pas beaucoup d’attention à la manière dont ces considérations ont affecté Truman,Eisenhower, Nixon, Bush ou Obama.
Payne aurait également été bien inspiré d’analyser davantage les médias d’information – une absence curieuse, étant donné qu’ils constituent un intermédiaire clé entre les présidents et l’électorat dans la diffusion d’informations (et de désinformations) sur la guerre et la diplomatie dans la période précédant un vote. Les sondages sont importants, mais les journalistes qui traduisent et analysent les données le sont tout autant. Le type de calculs rationnels mis en avant par Payne n’est pas toujours possible étant donné que les électeurs ne savent pas toujours ce qui se passe à l’étranger.
Pendant une grande partie de la période étudiée dans ce livre, les notions d’objectivité de la presse ont offert aux présidents une marge de manœuvre considérable pour tenir les informations à l’écart du public. Au début de la guerre du Viêt Nam, par exemple, les journalistes n’ont souvent pas remis en question les déclarations officielles qu’ils recevaient lors des briefings militaires et ont ensuite diffusé ces informations sans analyse critique. Aujourd’hui encore, de nombreux électeurs connaissent mal le rôle de Washington dans des régions clés du globe, d’autant plus que les médias délaissent les points chauds où les conflits font rage pour couvrir d’autres sujets, tels que le dernier scandale politique.
Enfin, Payne accorde trop peu d’attention au Congrès. Comme l’ont montré les politologues, le Congrès conserve un immense pouvoir pour influencer l’opinion des électeurs et attirer l’attention du public sur certains aspects de la politique étrangère par le biais d’enquêtes et de déclarations publiques, comme la campagne agressive menée cet été par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour promouvoir des initiatives visant à contrer la puissance économique croissante de la Chine. Les législateurs contrôlent également les cordons de la bourse, ce qui reste une considération importante pour les présidents lorsqu’ils envisagent une stratégie en temps de guerre.
Néanmoins, la question qui est au cœur du livre de M. Payne est une question que nous devons tous nous poser : La démocratie produit-elle de meilleurs ou de moins bons résultats lorsqu’il s’agit de faire la guerre à l’étranger ?
Bien que Payne n’ait pas de réponse claire, son livre met en évidence une longue histoire au cours de laquelle les préoccupations présidentielles concernant les élections ont abouti à des décisions « sous-optimales » en matière de politique étrangère, en particulier lorsqu’il s’agit de guerres asymétriques. « Les démocraties puissantes sont particulièrement mauvaises dans les petites guerres », écrit-il. La participation des États-Unis à ces conflits « limités » [tels que la Corée, le Viêt Nam et l’Irak] s’est caractérisée par des luttes longues et prolongées qui sapent le moral des troupes et aboutissent au mieux à un match nul, quand ce n’est pas à une défaite pure et simple.
Cette sombre conclusion est d’autant plus décourageante que Payne ne propose aucune solution convaincante aux graves problèmes qu’il identifie.

Des manifestants contre la guerre du Viêt Nam manifestent sur le National Mall à Washington, D.C., le 21 octobre 1967. AFP via Getty Images
Les problèmes créés par la pression démocratique ne disparaîtront pas. Pourtant, il s’agit là d’une caractéristique, et non d’un bogue, du système politique américain. Nous ne voudrions pas soutenir une politique où les présidents s’affranchissent de l’électorat. C’est en partie ce qui distingue les États-Unis des pays non démocratiques. C’est également l’une des forces les plus puissantes qui ont permis d’éloigner les présidents de leurs décisions les plus désastreuses, comme la pression électorale et populaire de la fin des années 1960 et du début des années 1970, qui a été essentielle pour mettre un terme à l’engagement des États-Unis au Viêt Nam.
Ce que les États-Unis peuvent faire, c’est œuvrer au renforcement de leur démocratie afin que le président reçoive des signaux précis de la position de l’électorat et que le public puisse garantir la responsabilité de tout commandant en chef qui s’engagerait dans des directions néfastes. Pour cela, il faut veiller à ce que les droits de vote soient respectés, que le collège électoral ne soit pas manipulé et que les procédures du Congrès ne favorisent pas perpétuellement les opinions anti-majoritaires et les calculs hyperpartisans. En bref, Washington doit mettre de l’ordre dans sa propre maison. C’est une chose que d’avoir des présidents qui équilibrent constamment les conseils stratégiques des experts et les pressions démocratiques, mais c’en est une autre lorsque ces pressions démocratiques sont rabougries et incomplètes.
La démocratie n’est pas toujours belle, mais c’est le meilleur système qui existe. Lorsque les processus fonctionnent, le responsable le plus puissant du pays ne peut pas se permettre de perdre de vue ce que pensent les électeurs. En retour, les électeurs ont la possibilité d’exprimer leur opinion, de remplacer les dirigeants par d’autres qu’ils jugent plus compétents et de participer aux décisions prises en temps de guerre au plus haut niveau du pouvoir.
Le fait que les présidents ne puissent échapper à la cage électorale, même lorsqu’ils mènent des guerres à l’étranger, est une bonne chose. Cela reste notre meilleur rempart contre les tendances impériales et autocratiques latentes dans toute position de pouvoir. Bien que ce contrôle puisse conduire à toutes sortes de mauvaises décisions et détourner les délibérations des préoccupations stratégiques, il permet aux dirigeants de Washington de rester ancrés dans la rue plutôt qu’au Pentagone.
Au fil du temps, cela reste notre meilleure assurance contre les commandants en chef qui mettent inutilement leurs troupes en danger et qui n’ont aucune raison de le faire.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.