Étiquettes
Maxime Cochelin
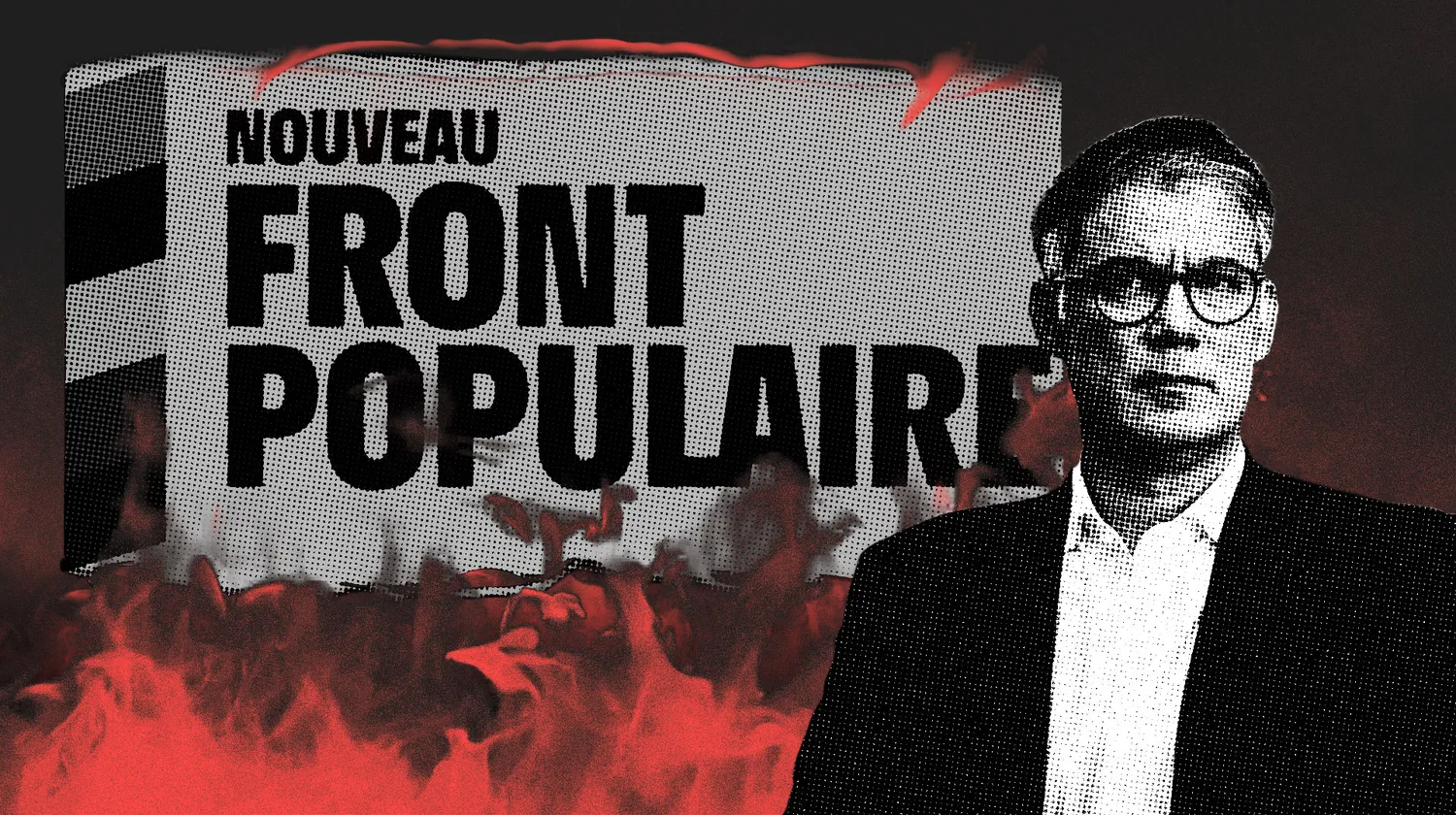
« Bruno Retailleau est un homme respectable avec des convictions. Je propose de voir, dans un an, combien il aura ramené chez eux de personnes en situation irrégulière dans notre pays. Je juge sur les faits. ». Bruno Retailleau, cet homme que la députée Rassemblement national Laure Lavalette décrit comme un « porte-parole du RN »et qu’elle invite même, parce que pourquoi pas finalement, à rejoindre le parti. L’homme de la « régression vers les origines ethniques », de l’idylle « je t’aime moi non plus » avec le complotiste réactionnaire Philippe de Villiers. L’homme d’une nouvelle circulaire pour accentuer encore le harcèlement administratif des personnes exilées et de l’utilisation des termes « français de papier » ou encore « ce sont des musulmans, ils sont noirs » pour parler des habitants de Mayotte. Cet homme, donc, est décrit comme « respectable » et avec des « convictions »par, surprises et roulements de tambours : Lionel Jospin. Le vieux Lionel, du trotskisme au racisme, spectaculaire dégringolade morale sur l’autoroute des abîmes.
Après avoir entendu ça, dans un geste a priori de bon sens, on se dit que le Parti socialiste va réagir. Un geste de désolidarisation, au moins, pour marquer le coup et acter une distance avec le spectre de l’ancien monde. Un peu comme l’on écarterait de la conversation le vieil oncle du bout de la table qui commence à raconter n’importe quoi après s’être envoyé cinq Ricard dans le buffet. Mais rien. Tout l’inverse même. Les « socialistes » ont préféré emboîter le pas de leur ancien mentor deux jours après, en déclarant avoir pris la décision de ne pas voter la censure du gouvernement. Dont acte : le jeudi 5 février, le budget a été adopté par l’Assemblée nationale via 49,3 et la censure n’a pas été votée par le PS ainsi que par le Rassemblement national. Main dans la main pour sauver Bayrou, Retailleau, Darmanin, Valls, et tous les joyeux lurons qui les accompagnent.
Félonie
Une décision avec l’apparence d’un grand écart. Olivier Faure, le soir de la nomination du précédent gouvernement, celui de Michel Barnier, dénonçait une « humiliation de la démocratie » et une « trahison du vote ». Carole Delga avait elle aussi appelé à censurer ce gouvernement « soutenu par l’extrême droite ». Même son de cloche pour Boris Vallaud qui justifiait le vote de la censure par le fait que Michel Barnier avait estimé « plus convenable de parler avec l’extrême droite qu’avec la gauche ». Dans une relative fidélité aux accords noués avec les autres composantes du NFP, certaines têtes d’affiche socialistes semblaient à cette époque « tenir la digue » vis-à-vis du Rassemblement national. Attitude qui, pour un parti supposément de gauche, apparaît être de l’ordre du minimum syndical.
Seulement voilà, les fondamentaux se sont depuis évaporés dans la nature. Le gouvernement Bayrou est resté, dans les grandes lignes, le même que le précédent : les composantes d’extrême droite s’y trouvent toujours, et les énoncés racistes continuent de pleuvoir. Le désormais fameux « submersion migratoire » en tête, bien sûr, locution de Jean-Marie Le Pen mobilisée par François Bayrou sur un plateau de télévision, juste après avoir vanté la supériorité d’une société sans métissage. Soit un positionnement qui emprunte, ni plus ni moins, à la rhétorique suprémaciste blanche. Raisons à priori déjà suffisantes pour acter la nécessité d’une censure. Pompon sur la Garonne, car il n’y a décidément rien à sauver, le budget soumis au vote des députés est le plus austéritaire de la 5e République. Un projet tout à fait clair, celui d’une casse sociale, immigrés et exilés en première ligne, avec une perspective encore plus funeste que celle proposée par Michel Barnier. Et les socialistes ont choisi de rouler là-dedans.
Pour légitimer cette trahison nette et sans bavure du mandat attribué par les électrices et électeurs aux dernières élections législatives, il a fallu labourer le terrain médiatique pendant plusieurs semaines. Tout un champ lexical a saturé les ondes : « responsabilité », « travail », « stabilité », « intérêt général ». Des réunions en série présentées comme une lutte acharnée contre le « blocage institutionnel », car la France « doit avoir un budget ». Opération organisée pour donner l’impression que les traîtres sont en fait les sauveurs, en se gardant bien de mentionner que les mécanismes constitutionnels français rendent impossible un « shutdown » à l’américaine. L’organisation du mensonge, donc, sans doute dans l’objectif de camoufler les réelles aspirations à l’origine de la manœuvre. Car la rhétorique du « sérieux » a eu son pendant négatif : « Il y a la gauche qui braille et la gauche qui travaille. LFI c’est la gauche qui braille » ; « Il n’y aura plus jamais d’alliance entre le PS et LFI » ; « Le NFP existe toujours mais M. Mélenchon en est sorti ». Et tout ça sous l’œil jubilatoire des journalistes de plateaux de télévision qui attendaient ce moment de toute évidence depuis plusieurs mois.
Retour aux sources
En première ligne de cette fausse rhétorique du sauvetage national et de la vraie offensive anti-LFI, des profils que l’on connaît bien : Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen ; Carole Delga, présidente de la région Occitanie ; Anne Hidalgo, maire de Paris ; François Hollande, député ; Bernard Cazeneuve, rien du tout. Et d’autres qui sortent de terre depuis quelques mois, comme de pures créations médiatiques : Philippe Brun, député ; Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen. Ne pas chercher midi à quatorze heures et regarder le spectacle tel qu’il est : le Parti socialiste s’est résigné à mener un calcul froid qui consiste à faire exploser le Nouveau Front Populaire pour garantir une certaine autonomie en vue des prochaines échéances électorales, notamment municipales. Les postes de nombreuses figures au cœur de ce nouvel agenda en dépendent. Calcul envisageable aujourd’hui davantage qu’hier de par la taille du groupe PS à l’Assemblée nationale : celui-ci a doublé après les élections législatives post-dissolution. Cynisme politique des plus classiques qui vient mettre fin à l’exception et rétablit la règle.
Car l’histoire du Parti socialiste, il n’est jamais inutile de le rappeler, se révèle bien éloignée de la défense-esbroufe façon Olivier Faure d’une quelconque position de « rupture ». En 1974, après un coup d’État militaire soutenu par les États-Unis, Augusto Pinochet devient président du Chili et remplace Salvador Allende, poussé au suicide. Sous la houlette de ceux qu’on appelle les « Chicago Boys », et à travers une répression par le sang, des réformes économiques drastiques sont menées : libéralisation des prix et des taux d’intérêts, réduction d’impôts et de la dépense publique. Un premier coup d’essai de l’organisation de la compétitivité généralisée qui sera d’abord importé en France, le passé regorge toujours de surprises, par le Parti socialiste lui-même (1). « Là où il n’y a plus de compétition, il n’y a plus de vie. La compétition est de l’ordre du biologique » disait Michel Rocard, premier ministre de François Mitterrand entre 1988 et 1991. Le système de protection sociale est « une puissante incitation à ne pas travailler » disait Jacques Delors, artisan majeur de la construction européenne aux ambitions présidentielles ratées. Une conversion de l’ensemble du parti à la « nouvelle raison du monde » (2), canevas idéologique du « tournant de la rigueur » qui, dès 1983, a entériné une capitulation définitive à l’égard du monde économique.
Dans cette fuite en avant, la dynamique a toujours été double : d’une part approfondir les mécanismes de déploiement du marché dans toutes les sphères de la vie, et d’autre part anéantir méthodiquement les propositions d’alternatives à gauche. Ainsi de Jacques Delors qui refusait toute perspective d’accord avec le PCF tout en annonçant que les impôts et cotisations des entreprises devaient cesser d’augmenter. Ainsi de Lionel Jospin qui voulait construire une « nouvelle alliance » par une mise à l’écart implicite de la base ouvrière tout en obtenant, avec succès, le trophée du Premier ministre qui privatisa le plus d’entreprises de l’histoire de la 5e République. Ainsi de François Hollande qui mena à son terme la réforme du droit du travail la plus violente jamais adoptée tout en fustigeant les « frondeurs » responsables, selon lui, de ses propres incuries. Si Macron « n’est pas socialiste », le Parti socialiste est macroniste depuis 40 ans déjà. Et cette non-censure en est un rappel cinglant.
Complicité
Cette stratégie du PS a été couronnée d’échec, responsable de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Événement qui n’a pas empêché François Hollande de reproduire les mêmes erreurs, tout en expliquant que là n’était pas le virus mais bien le remède. Et nous voilà repartis, aujourd’hui, pour un énième tour de manège. Une drôle de lecture du monde basée sur l’inversion de responsabilité, non sans rappeler les développements de la Fondation Saint-Simon. Autour de figures telles que François Furet et Pierre Rosanvallon, ce club actif de 1982 à 1999 avait la vocation de faire se rencontrer hommes politiques « de gauche » et patronat. Tout ça pour préparer la naissance d’une quasi nouvelle République, celle du « centre » (3), sorte de triomphe final de la démocratie après la chute du Mur de Berlin et du Parti communiste. En arrière-plan, une croyance tenace dont François Furet s’est fait le prédicateur sa vie durant : la rupture porte en elle l’effondrement, la terreur, voire le totalitarisme (4). Vernis commode, rendu caduc par les recherches historiques (5), mais qui semble persister à saturer les esprits des socialistes dits « raisonnables ». Et ce probablement pour une raison relativement simple : cette rhétorique offre l’alibi intellectuel d’un « progressisme » qui ne passe pas par le chamboulement des hiérarchies en place. Une rencontre aux chandelles entre la stratégie politicienne et les intérêts de classe.
Petit problème : il n’aura échappé à personne, sauf visiblement à ces fameux socialistes, que ce projet de « République du centre » encadré par un conservatisme version branchouille, s’est effondré sur lui-même. Ou, pour le dire autrement, a toujours été une vaste arnaque. Des 3000 morts de la dictature d’Augusto Pinochet à l’écrasement des mineurs anglais par Margaret Thatcher, en passant par l’éborgnement des gilets jaunes et la répression des manifestations contre la réforme des retraites : les réformes d’inspiration néolibérale se sont partout déployées dans la violence, bien loin d’une supposée culture du compromis brandie à longueur de plateaux de télévision. Un passage en force constant, comme un horizon qui se déploie façon bulldozer : baisse de l’espérance de vie en bonne santé, délitement des structures de solidarité, effondrement des services publics, flambée des pathologies psychologiques et psychiatriques, accélération de la répression des personnes immigrées et exilées. Et, bien sûr, pendant que les plus pauvres souffrent et sont martelés par l’injonction constante à « faire des efforts », les grandes fortunes ne cessent de croître, sponsorisée par une pluie de subventions publiques. Entre 2019 et 2024, la fortune cumulée des milliardaires français a augmenté de 24 milliards d’euros.
Une dégringolade qui apparaît dorénavant comme une sorte d’hors-d’œuvre. Nous voilà rentrés dans l’étape suivante. Salut nazi et déportation forcée de personnes exilées sur fond de projet officiel de génocide des Palestiniens : ça c’est pour l’outre-Atlantique. Toujours un peu d’avance là-bas, mais, pas de panique, ici ça emboîte le pas façon bottes noires. La remise en cause du droit du sol se limitait d’abord à Mayotte, un scandale en tant que tel, et puis voilà qu’on en parle pour l’ensemble du pays. La construction de places de prison et de CRA se poursuit à rythme soutenu, tout comme le surarmement policier, la criminalisation des mineurs, la censure de la presse. Pendant ce temps, Elon Musk est invité au sommet sur l’intelligence artificielle par Emmanuel Macron et Marine Le Pen nage dans un océan de bonheur à force de ramasser toutes les miettes de cette débâcle. Difficile de ne pas penser, bien sûr, à la manière dont chefs d’État et capitalistes se sont jadis couchés face au Führer. Avec une précision importante : dans l’Allemagne des années 20 et 30, le capitalisme subit une crise structurelle que le parti nazi promet de dépasser. Bien différent d’aujourd’hui où les grandes fortunes ne cessent d’augmenter, où les réseaux sociaux, médias et firmes culturelles sont détenus par les mêmes personnes, où l’industrie fossile élargit toujours davantage sa puissance. Plus que jamais, toutes les vannes sont ouvertes.
Ce vaste projet de destruction qui emporte l’humanité vers des profondeurs insondables, le Parti socialiste a choisi de le rendre possible. Pire, par l’organisation mensongère d’un faux jeu de compromis, d’y collaborer. Collaborer pour détruire ce qu’il reste de la sécurité sociale, de l’hôpital, de l’école pour tous, de l’université et du savoir gratuit, de la justice, d’une culture protéiforme, de l’environnement. En bref, collaborer à détruire de ce qu’il reste de la vie, et, peut-être surtout, de ce qu’il reste de l’espoir d’un autre monde.
Notes :
(1) Bruno Amable, La résistible ascension du néolibéralisme. Modernisation capitaliste et crise politique en France (1980-2020), La Découverte, Paris, 2021.
(2) Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2010.
(3) François Furet, Jacques Julliard et Pierre Rosanvallon, La République du centre. La fin de l’exception française, Calmann Lévy, Paris, 1994.
(4) François Furet, Penser la Révolution française, Gallimard, Paris, 1983.
(5) Sophie Wahnich, La Révolution française n’est pas un mythe, Klincksieck, Paris, 2019.
