Étiquettes
Allemagne, Expansion de l'OTAN vers l'Est, ordre mondial, OTAN, Russie
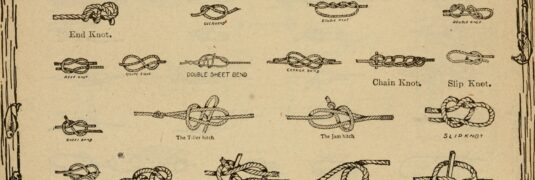
Fiodor A. Loukianov
Certaines choses symbolisent des processus historiques et des époques entiers.
Le mur de Berlin en est peut-être l’exemple le plus frappant. Qu’est-ce qui pourrait mieux symboliser la division de l’Europe et du monde en deux blocs idéologiquement, militairement et politiquement irréconciliables ? Une fortification massive et technologiquement avancée, traversant le cœur d’une ville phare du Vieux Continent. En janvier 1989, le dirigeant est-allemand Erich Honecker proclamait que la « barrière de protection antifasciste » resterait en place pendant encore cent ans. Moins d’un an plus tard, elle tombait, tout comme, et ce n’est pas un hasard, le gouvernement de Honecker et, peu après, l’ensemble de l’État est-allemand.
La réunification de l’Allemagne, à la suite de l’accord du 3 octobre 1990, a marqué un tournant. Un grand État, qui avait été source de tensions et de guerres pendant 150 ans, a refait son apparition sur la carte de l’Europe. Mais plus encore, les principes de la réunification allemande ont défini la politique européenne pendant les trente années suivantes, aboutissant au conflit ukrainien, qui a éclaté en 2014 et s’est transformé en une guerre interétatique à grande échelle en 2022. Ces événements, quelle que soit la manière dont on les évalue, ont été déclenchés par les accords de 1990 (ou plutôt par leur absence).
Perdre en quantité, gagner en qualité
Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’abolition de l’ancien État allemand (le Troisième Reich) semble plus ambiguë qu’après la guerre. D’une part, l’Europe, en tant que communauté d’États, s’est débarrassée de sa principale source d’instabilité : l’Allemagne, trop forte, trop ambitieuse et incapable de s’intégrer dans des alliances profondes. D’autre part, l’Europe n’y est pas parvenue seule. Les deux guerres mondiales interconnectées, déclenchées par le Vieux Continent, n’ont pas permis de résoudre ses contradictions. Il a fallu l’intervention à grande échelle de forces extérieures (bien que culturellement et historiquement enracinées en Europe), à savoir l’Union soviétique et les États-Unis, pour enfin remettre de l’ordre dans ce chaos. Mais le prix à payer a été élevé : l’Europe a perdu son rôle central séculaire dans la politique mondiale. De plus, la Seconde Guerre mondiale a directement accéléré le démantèlement des empires coloniaux européens en Asie et en Afrique.
Ayant perdu en quantité (prédominance internationale et autonomie stratégique), l’Europe a gagné en qualité (de sa propre vie).
Tout d’abord, la « question allemande » avait disparu, et avec elle la crainte d’une nouvelle guerre entre les grandes nations européennes. L’Europe pouvait ainsi se concentrer sur son amélioration, sa reprise économique et sa croissance.
Deuxièmement, les principaux États d’Europe occidentale n’avaient plus à s’inquiéter d’éventuelles surprises de la part d’une Europe de l’Est historiquement agitée. Le rideau de fer permettait à l’Occident de dénoncer le contrôle totalitaire de l’Union soviétique sur l’Europe de l’Est, mais le déchargeait totalement de toute responsabilité à cet égard.
Troisièmement, la périphérie occidentale du Vieux Continent a carrément cédé à son protecteur nord-américain le droit et le devoir de réfléchir de manière stratégique. Jamais auparavant les Européens n’avaient eu le luxe de transférer à quelqu’un d’autre la responsabilité de leur propre sécurité. Cela était particulièrement favorable à l’Allemagne, à qui il était strictement interdit de réfléchir à nouveau de manière stratégique.
Tout cela a rendu possible l’intégration européenne. À l’apogée de sa prospérité, ce fut peut-être le projet politique le plus réussi de l’histoire européenne. Une combinaison heureuse de plusieurs circonstances – la présence d’un ennemi extérieur indéniable (l’URSS) qui a consolidé la communauté européenne, le patronage sécuritaire d’un partenaire senior (les États-Unis) et les avantages pratiques de l’homogénéité des valeurs – a permis à l’Europe de construire un système unique de relations interétatiques dans les années 1950-1990.
« Il est important de noter que la division idéologique de l’Europe, incarnée par l’existence de deux États allemands, a facilité plutôt qu’entrave ce projet ».
Non pas « si », mais « comment
Pourtant, les changements en Europe ont été soudains. Lorsque Ronald Reagan a assuré à Mikhaïl Gorbatchev, sur la Place Rouge, au début de l’été 1988, qu’il ne considérait plus l’URSS comme un empire du mal, personne n’aurait pu imaginer qu’un gouvernement non communiste serait formé en Pologne à peine un an plus tard, et que le camp socialiste européen disparaîtrait six mois après. La chute du mur de Berlin et du gouvernement communiste de la RDA a soulevé la question de la réunification allemande, à laquelle personne n’était préparé. Ces événements ont pris les dirigeants ouest-allemands au dépourvu, tandis que la joie des grandes puissances européennes face à l’affaiblissement de leur adversaire juré (l’URSS) se mêlait à la crainte instantanément ravivée d’une Allemagne puissante.
Lorsque les discussions sur la réunification allemande ont commencé, les principaux responsables politiques européens – François Mitterrand, Margaret Thatcher, Giulio Andreotti et les dirigeants du Benelux – se sont montrés pour le moins peu enthousiastes à cette idée. La phrase attribuée à Andreotti « J’aime tellement l’Allemagne que je préférerais même qu’il y en ait deux » reflétait l’état d’esprit général. De l’autre côté de l’océan, George H. W. Bush et son équipe de réalistes tentaient de trouver le moyen d’organiser la réunification de la manière la plus avantageuse pour les États-Unis.
« Paradoxalement, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev semblait être le plus optimiste de tous ».
Contrairement aux Européens, le Kremlin ne voyait aucune raison de craindre sérieusement que l’Allemagne reprenne son statut de grande puissance, et c’est précisément la position de la Russie qui a le plus contribué à la réunification rapide et globalement assez harmonieuse de l’Allemagne. Aujourd’hui, la position de Gorbatchev est considérée comme naïve, c’est le moins qu’on puisse dire. Bien sûr, il est facile de voir les conséquences des décisions prises à la hâte à l’époque. Mais il serait simpliste de tout mettre sur le compte du manque de professionnalisme des dirigeants soviétiques. Laissant les détails (assez riches) aux historiens, je vais essayer de résumer les motivations de Gorbatchev et de ses associés, et d’évaluer leur bien-fondé à la lumière des connaissances actuelles.
Tout d’abord, le Kremlin pensait que le peuple allemand finirait de toute façon par s’unir et qu’il était donc inutile de résister à un processus historique inévitable. Rétrospectivement, cela n’est pas si évident : 35 ans plus tard, la frontière entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est est encore presque parfaitement reproduite sur les cartes des résultats électoraux allemands. Mais si cela montre clairement les limites de la politique d’intégration de l’Allemagne, qui lui a coûté des centaines de milliards de dollars, cela ne signifie pas pour autant que les deux États auraient pu être préservés dans les années 1990. Quoi qu’il en soit, à la fin de 1989 et au début de 1990, les dirigeants de l’URSS (et d’autres États) considéraient l’unification allemande comme inévitable. La question n’était pas de savoir « si », mais « comment ».
Et c’est là que l’on peut critiquer plus concrètement les dirigeants soviétiques.
L’ordre mondial au lieu de l’ordre interne
Gorbatchev et Honecker se détestaient. Gorbatchev attribuait l’effondrement de la RDA à son refus obstiné d’accepter la perestroïka, ce qui a probablement conduit à sa perception émotionnelle des choses.
Mais l’Occident applaudissait la nouvelle pensée politique de Gorbatchev, et la fin de la guerre froide (proclamée par Reagan) permettait une approche coopérative.
Cela ne signifiait pas pour autant que le Kremlin envisageait l’avenir avec optimisme. Après tout, Gorbatchev avait été façonné par la guerre froide (même s’il avait également un côté libéral issu du dégel politique des années 1960) et était entouré de personnes aux opinions diverses, dont certaines nourrissaient une profonde méfiance à l’égard de l’Occident. Mais en 1990, il avait acquis suffisamment de confiance en lui pour rejeter les opinions indésirables et suivre ses propres convictions, fondées principalement sur la nouvelle pensée politique qu’il avait nourrie depuis 1986 et qui allait sous-tendre un « nouvel ordre mondial ».
Les architectes de la perestroïka se concentraient sur les questions internationales, non pas parce que les questions nationales n’étaient pas importantes, mais parce qu’il semblait logique et rationnel de remodeler la politique étrangère et de s’éloigner de la confrontation qui avait atteint une impasse au milieu des années 1980. De plus, il n’y avait pas de consensus ni de plan clair sur ce qu’il fallait faire au niveau national. En conséquence, la politique étrangère a pris de plus en plus d’importance, nécessitant une coopération étroite avec d’anciens adversaires.
Un mauvais compromis ?
Les griefs à l’encontre des dirigeants soviétiques peuvent être grossièrement divisés en deux catégories : les griefs matériels, qui étaient immédiatement évidents, et les griefs conceptuels, qui ne se sont manifestés que progressivement.
Les premiers affirment que la Russie a reçu trop peu d’argent (12 milliards de marks) pour avoir accepté la réunification allemande et le retrait des troupes. Les Allemands étaient probablement prêts à payer davantage. Les dirigeants allemands, dont Helmut Kohl, ont par la suite admis avoir été surpris par la modestie de Moscou et s’être préparés à des montants beaucoup plus élevés. Mais ils ne l’ont pas dit aux négociateurs soviétiques. Le ministre des Finances Theo Waigel a négocié comme seul un Allemand pouvait le faire et a finalement réduit le prix par rapport aux 15-16 milliards initialement demandés.
« Moscou aurait probablement pu négocier un meilleur accord, mais cet argent, même s’il avait été dix fois plus important, aurait probablement disparu sans laisser de traces dans le trou noir de la crise systémique de l’URSS ».
Gorbatchev écrivit plus tard qu’il considérait les négociations acharnées comme inacceptables par principe, car l’idée était d’établir une relation qualitativement nouvelle fondée sur la confiance. Peut-être ces déclarations n’avaient-elles pour but que de sauver la face. Mais il est plus probable que Gorbatchev croyait sincèrement en un nouvel ordre mondial fondé sur la confiance entre anciens adversaires. Et nous en revenons ici au deuxième type de plainte, concernant la manière dont a été géré le système de sécurité européen issu de la réunification allemande.
L’OTAN comme condition principale
Pour les alliés occidentaux de l’Allemagne, son statut au sein de l’OTAN revêtait une importance fondamentale. Les États-Unis étaient naturellement soucieux de maintenir leur présence stratégique en Europe, car la réunification allemande mettait officiellement fin à toute la période d’après-guerre. Les Européens étaient alarmés par la « question allemande », à savoir la renaissance d’un pays puissant au passé effrayant. Des deux côtés de l’océan, l’OTAN était considérée comme la solution. La formule classique de Lord Ismay, premier secrétaire général de l’OTAN, « garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands en bas », restait d’actualité, malgré les transformations géopolitiques spectaculaires.
Washington, Bonn et d’autres capitales étaient conscientes que Moscou ne verrait pas d’un bon œil l’adhésion d’une Allemagne unifiée à l’OTAN. Tout cela ressemblait à un retrait non dissimulé : la partie de l’Allemagne précédemment contrôlée par les Soviétiques passait simplement sous le contrôle de l’OTAN.
« L’URSS a suggéré que l’Allemagne reste en dehors des blocs, sa neutralité rassurant tout le monde. Mais cela ne convenait pas du tout aux alliés occidentaux ».
Pour persuader le Kremlin, les Américains et les Européens ont fait valoir que l’OTAN empêcherait d’éventuelles rechutes, surtout si les Allemands retrouvaient un jour leur mémoire historique gênante. L’OTAN ne leur permettrait tout simplement pas de se lancer. Et l’OTAN, de toute façon, n’était plus hostile à la Russie, puisque la guerre froide était terminée… (Quelques années plus tard, ils réagiront de la même manière aux avertissements de la Russie selon lesquels l’adhésion des pays d’Europe de l’Est à l’OTAN rendrait celle-ci anti-russe. Bruxelles s’empressera de rassurer Moscou en affirmant que, au contraire, les membres anciens de l’alliance contrôleraient toute tendance anti-russe des nouveaux arrivants. Inutile d’expliquer aujourd’hui qui avait raison.)
Aucun engagement
L’OTAN se préparait à un long conflit, mais à la grande joie des négociateurs occidentaux stupéfaits – et à la grande horreur d’au moins certains des associés de Gorbatchev – ce dernier accepta assez rapidement l’adhésion de l’Allemagne à l’OTAN. Au cours du processus, les Soviétiques reçurent l’assurance qu’il n’était pas question d’une expansion de l’OTAN et qu’il s’agissait uniquement d’un pays, dans l’intérêt du calme général. Divers responsables politiques, menés par le secrétaire d’État américain James Baker, ont promis que les infrastructures de l’OTAN ne se déplaceraient « pas d’un pouce » vers l’est. Mais aucun traité n’a été signé à cet effet, ni même demandé par le Kremlin. Ainsi, lorsque la Russie, en tant que successeur de l’URSS, a commencé à protester trois ou quatre ans plus tard contre l’élargissement de l’OTAN à l’ancien Pacte de Varsovie (la première vague comprenait la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie), Moscou s’est vu répondre : personne n’avait rien promis, il s’agissait simplement d’une conversation générale.
Gorbatchev, qui a ensuite été vivement critiqué pour l’absence d’accords contraignants, parlait généralement de projets visant à instaurer un climat de confiance fondamentalement nouveau dans le cadre d’un « nouvel ordre mondial ». En effet, si celui-ci s’était concrétisé, aucun accord spécifique sur la non-expansion de l’OTAN n’aurait été nécessaire. Mais les choses se sont déroulées différemment, en raison de l’effondrement de l’URSS. Invoquant cet argument, Gorbatchev a rejeté la responsabilité sur ses adversaires qui aspiraient à la désintégration de l’Union soviétique.
Il y a une part de vérité dans cela. Quoi qu’il en soit, plusieurs années plus tard, alors que l’OTAN avait presque triplé sa taille, les Américains ont commencé à dire ouvertement ce qui n’était auparavant qu’une insinuation : des promesses verbales avaient été faites, mais dans une certaine situation géopolitique ; avec la disparition de l’Union soviétique, la situation avait radicalement changé et rendu ces conversations caduques.
« On peut imaginer ce qui se serait passé si le Kremlin avait obtenu des garanties écrites de non-expansion de l’OTAN en 1990. Mais cela n’aurait guère changé la logique des événements de la fin du XXe et du début du XXIe siècle ».
Après tout, les institutions atlantiques se sont développées non pas parce qu’il n’y avait pas de mémorandums signés, mais parce que l’ennemi juré et le contrepoids de l’Occident avaient disparu, créant un vide qui allait inévitablement être comblé par l’influence occidentale jusqu’à ce que les opposants à la domination occidentale (re)prennent suffisamment de force.
Quoi qu’il en soit, les derniers dirigeants soviétiques ont négligé sans réfléchir les conséquences stratégiques de la réunification allemande à un moment où ils auraient pu l’influencer. Le consentement à l’adhésion d’une Allemagne unifiée à l’OTAN et à la formule (reprise plus tard dans la Charte pour une nouvelle Europe) selon laquelle chaque État est libre de choisir ses propres arrangements en matière de sécurité a ouvert la voie à l’élargissement illimité de l’OTAN. Après tout, tout le monde a ce droit, et il doit être respecté.
Le statu quo sacré
Les personnes nées l’année de la réunification allemande ont déjà grandi. Et les 35 dernières années ont été si mouvementées que la réunification semble appartenir à un passé lointain. L’Europe a suivi l’exemple de l’Allemagne en matière d’unification, un processus qui a atteint son apogée dans la seconde moitié des années 2000, mais qui a finalement plongé dans une crise de plus en plus palpable, directement liée aux développements mondiaux.
Les principaux pays occidentaux ont eu du mal à surmonter la crise financière mondiale de 2008, qui a particulièrement touché l’UE. Le déplacement vers l’est du centre de gravité international, sous l’impulsion de la montée en puissance de la Chine, a affecté les relations transatlantiques. La Russie, ayant retrouvé sa force, a commencé à résister à la pression euro-atlantique, désormais par la force.
« En Europe même, l’expansion et l’intégration se sont heurtées, créant des problèmes sans solution à long terme ».
Les autorités européennes ont généralement opté pour le pilotage automatique, évitant de réfléchir sérieusement à l’avenir, mais parvenant parfois à masquer les fissures en intensifiant encore les politiques qu’elles ont choisies.
Cette approche a été incarnée par la chancelière allemande de longue date (2005-2021), Angela Merkel, une dirigeante autoritaire et une tactique habile qui a fui toute question stratégique. Elle symbolise la politique du statu quo qui a profité à l’Europe et à l’Allemagne depuis le début des années 1990. Il est également symbolique que cette politique se soit effondrée presque immédiatement, en février 2022, après le départ de Merkel.
De l’unité au désordre
L’Allemagne célèbre aujourd’hui le 35e anniversaire de sa réunification dans un contexte de confusion sociopolitique : la coalition au pouvoir, avec une chancelière affaiblie, ne bénéficie pas de la confiance de la plupart des Allemands ; les forces antisystémiques gagnent en popularité ; les problèmes économiques structurels s’accumulent ; les autorités admettent ouvertement que les modèles économiques et sociaux actuels doivent être révisés ; personne ne sait à quoi devraient ressembler les nouveaux modèles. Tout cela se produit dans un contexte de transformation des relations (extrêmement désagréables pour l’Europe et l’Allemagne) avec les États-Unis, qui transfèrent systématiquement tous les coûts possibles vers le Vieux Continent et exigent de lui une loyauté totale. Et pour couronner le tout, les élections successives révèlent des différences sociopolitiques persistantes entre les « nouveaux » et les « anciens » Länder.
L’euphorie du début des années 1990 s’est dissipée depuis longtemps. Elle résultait moins d’un triomphe géopolitique ou d’une prospérité (même si les deux se sont produits) que de la conviction que le système international avait atteint son niveau de développement final et approprié. Le sentiment d’absolue justesse morale et d’irréversibilité correspondante de la victoire (obtenue, il est important de le souligner, sans recours à la force) a complètement effacé la capacité de doute chez les Allemands, qui sont naturellement enclins à moraliser et incapables de s’écarter d’une voie choisie tant qu’ils ne rencontrent pas un obstacle insurmontable.
Après 1991, l’Europe en est venue à se considérer comme le prototype du type de relations internationales qui finirait par régner partout. Aujourd’hui, le monde, mené par le protecteur américain de l’Europe, s’est engagé dans une direction complètement différente, celle que l’Europe avait fièrement déclarée irrémédiablement révolue. On ne sait pas très bien ce que l’Union européenne devrait faire dans cette situation.
« Contrairement aux États, qui peuvent rapidement changer de cap si nécessaire, l’UE est trop complexe pour cela ».
Tout cela génère une frustration qui se manifeste par une confusion sociale et par la volonté de plus en plus agressive des élites d’unir le continent sur une base anti-russe. Ce qui avait si bien commencé a maintenant déraillé, et la Russie est seule responsable. On peut considérer cela comme un symptôme de névrose. Mais l’histoire montre que la névrose en Europe, et en particulier en Allemagne, engendre des catastrophes bien au-delà de ses frontières. L’histoire s’apprête à prendre un nouveau tournant radical.
Lukyanov, F.A., 2025. From Euphoria to Neurosis. Russia in Global Affairs, 23(4), pp. 5–12. DOI: 10.31278/1810-6374-2025-23-4-5-12
Université nationale de recherche – École supérieure d’économie, Moscou, Russie
Faculté d’économie mondiale et d’affaires internationales
Professeur de recherche ;
Club de discussion Valdai
Directeur de recherche
