Étiquettes
épuisement permanent, confusion diplomatique, Etats-Unis, gestion permanente des crises, Iran, Israël, la guerre contre la multipolarité, la sécuritocratie, un étranglement lent, Venezuela
Pourquoi la « désescalade » de l’Occident envers l’Iran n’est qu’une guerre plus silencieuse
Nel Bonilla

Une narration gagne du terrain : face à des risques croissants et aux avertissements iraniens, l’administration Trump serait en train de reculer devant la confrontation avec Téhéran. Le retrait partiel d’un groupe aéronaval, les pourparlers à Mascate en Oman et le ton plus modéré des États-Unis sont interprétés comme des signes de retenue, de réajustement, voire d’un nouveau réalisme à Washington. Cette lecture est dangereusement myope. Elle méconnaît la logique stratégique qui régit actuellement le système atlantique, ce que j’ai appelé l’État bunker. Ce qui ressemble à une désescalade n’est, dans cette logique, qu’une transition vers une forme de guerre plus durable et plus impitoyable. Le système transatlantique s’oriente vers la méthode la mieux adaptée à la gestion à long terme de ses propres signes de déclin : l’étranglement économique par le contrôle maritime, les opérations secrètes de déstabilisation et les frappes cinétiques gardées en réserve. La forme de la guerre a changé. L’objectif reste le même.
La plupart des analyses traditionnelles utilisent encore un modèle du XXe siècle : l’escalade équivaut à un renforcement visible des troupes, à des bombardements massifs et à une invasion, ou du moins à la préparation de telles opérations. Si vous suspendez ces opérations ou cessez de les menacer publiquement, vous obtenez une « désescalade ». Vu sous cet angle, les événements récents ressemblent effectivement à un recul : le repositionnement partiel signalé de l’USS Abraham Lincoln depuis la mer d’Oman, la chorégraphie diplomatique des pourparlers indirects à Mascate, à Oman, et les articles de presse qui présentent les nouvelles sanctions comme un moyen de négociation plutôt que comme un élément de l’effort de guerre en cours contre l’Iran.
Mais cette interprétation ignore que les préparatifs du blocus et l’architecture des sanctions restent pleinement en place et sont renforcés, et non assouplis. De plus, la guerre secrète et financière contre l’Iran s’intensifie, elle ne ralentit pas. Enfin, la présence militaire américaine dans le Golfe, qui compte entre 30 000 et 40 000 soldats à portée des missiles iraniens, n’a pas changé de manière significative. Il ne s’agit donc pas d’un recul, mais d’une préparation ouverte à une guerre hybride permanente, que le système transatlantique préfère désormais.
Des frappes aériennes à la guerre économique : le blocus et le siège comme armes principales
Si nous définissons la guerre uniquement comme un événement qui se produit lorsque des bombes tombent ou que les parlements la déclarent officiellement, nous oublions que la guerre hybride contre l’Iran bat déjà son plein. Depuis fin 2025, les mesures prises par Washington ont ajouté le contrôle physique des flux énergétiques aux sanctions déjà en place.
En décembre 2025, Trump a ordonné un blocus naval complet des pétroliers sanctionnés à destination ou en provenance du Venezuela, une mesure qui, selon les définitions classiques du droit international, constitue clairement un « acte de guerre ». Dans le cas de l’Iran, la même administration ne met pas (encore) en place un « blocus total » officiellement déclaré, mais un blocus pétrolier de facto qui se resserre rapidement : après l’enlisement des négociations sur le nucléaire à Oman début février 2026, Washington a annoncé des sanctions supplémentaires contre le secteur pétrolier iranien, visant les entreprises et les intermédiaires qui commercialisent du pétrole brut et des produits pétrochimiques iraniens. Parallèlement, le département d’État a commencé à démanteler systématiquement la « flotte fantôme » iranienne. Dans une déclaration de février 2026, il a désigné 14 pétroliers de la flotte fantôme comme biens bloqués et a sanctionné 15 entités et 2 personnes impliquées dans le transport ou le commerce de pétrole, de produits pétroliers ou de produits pétrochimiques d’origine iranienne, s’engageant à « continuer à agir contre le réseau des transporteurs et des négociants ». En outre, les forces américaines ont physiquement saisi plusieurs pétroliers : le Marinera après une poursuite de deux semaines dans l’Atlantique près de l’Islande ; le Sophia, transportant deux millions de barils de pétrole brut vénézuélien dans les Caraïbes ; et d’autres navires liés à la flotte fantôme iranienne.
Il s’agit d’une action ciblée, et non d’un simple geste symbolique : l’Iran exporte environ 1,3 à 1,8 million de barils de pétrole par jour, dont environ 90 % vers la Chine. Réduire une partie substantielle de ces exportations équivaut, sur le plan fonctionnel, à des frappes soutenues sur les principales artères de l’économie iranienne.
« Ruiner à nouveau l’Iran »
Les responsables de l’administration Trump ont été inhabituellement explicites sur leurs actions. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, s’est vanté que la campagne de pression maximale était « conçue pour faire s’effondrer l’économie iranienne déjà en difficulté », pour « faire s’effondrer les exportations pétrolières iraniennes » et pour « fermer le secteur pétrolier iranien ». Il s’est réjoui des résultats : dépréciation de la monnaie, faillites bancaires, pénurie de dollars, paralysie des importations, puis il a ajouté :
« C’est pourquoi les gens sont descendus dans la rue… c’est de la diplomatie économique. Sans un seul coup de feu. »
S’adressant à Wall Street à l’Economic Club of New York en mars 2025, Bessent l’a dit encore plus clairement : l’objectif était de « ruiner à nouveau l’Iran ». La salle remplie de financiers a applaudi.
Les sanctions comme guerre structurelle
Nous assistons à la structuralisation des sanctions en tant qu’état de guerre permanent. Les données de la Banque mondiale et des Nations unies sur les droits humains montrent une tendance claire : après l’assouplissement des sanctions dans le cadre de l’accord nucléaire JCPOA de 2015, l’inflation iranienne est tombée à environ 7 % en 2016. Lorsque Trump a déchiré l’accord unilatéralement en 2018 et réimposé des sanctions en violation de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, l’inflation est remontée à 40-50 % et s’y est maintenue. Les rapporteurs spéciaux de l’ONU ont averti à plusieurs reprises que les sanctions unilatérales des États-Unis contre l’Iran, Cuba et le Venezuela violaient le droit international et risquaient de provoquer des « catastrophes humanitaires d’origine humaine », avec pour conséquences probables la famine et le déni des droits fondamentaux.
Bien sûr, rien de tout cela n’est conceptuellement nouveau en ce qui concerne l’utilisation des sanctions. Une note du département d’État de 1960 sur Cuba en exposait déjà le principe : l’objectif de l’embargo était « d’affaiblir la vie économique de Cuba » et « de provoquer la famine, le désespoir et le renversement du gouvernement ». Ce qui est nouveau, c’est la « bunkerisation » de cette logique : des plans autrefois considérés comme des options politiques sont désormais intégrés dans une structure permanente, appliquée par défaut à tout État qui favorise la résilience multipolaire.
Le Venezuela comme cas d’étude : la sécuritocratie et la guerre contre la multipolarité
Ce qui s’est déroulé au Venezuela le 3 janvier 2026 ne doit pas être considéré comme une aberration, ni comme une escalade soudaine provoquée par des événements nationaux à court terme. C’était loin d’être le cas. Il s’agissait plutôt de l’exécution d’une opération géopolitique préparée depuis un certain temps sur les plans intellectuel, institutionnel et doctrinal. Qualifier cet événement de coup d’État géopolitique est une description appropriée de ce qui s’est déroulé ce jour-là. Le Venezuela a connu diverses formes de siège depuis qu’Hugo Chávez a rompu avec la subordination hémisphérique de l’après-guerre froide. Mais la phase actuelle est qualitativement différente. Elle se déroule dans un monde où la primauté des États-Unis n’est plus considérée comme acquise, où la croissance hors du contrôle occidental ne conduit plus automatiquement à l’effondrement (ou plutôt à être effondrée), et où les alignements multipolaires constituent un défi structurel, et pas seulement idéologique, pour les élites du pouvoir occidental. L’inquiétude qui motive cette escalade est que des relations financières, diplomatiques et sécuritaires alternatives puissent persister et se développer. Cela est intolérable pour une puissance hégémonique en déclin dont le pouvoir repose de plus en plus sur des moyens de coercition.
L’une des articulations les plus révélatrices de cette logique apparaît dans les travaux de R. Evan Ellis, professeur de recherche sur l’Amérique latine à l’Institut d’études stratégiques de l’US Army War College. Son article de septembre 2025, intitulé « Finally the Endgame for Venezuela? » (Enfin la fin du jeu pour le Venezuela ?), modélise la manière dont l’escalade pourrait se dérouler. Dans le contexte géopolitique actuel, la force devient un mécanisme de signalisation où l’action cinétique devient communication. Du moins en ce qui concerne les États-Unis.
Ellis décrit les opérations récentes comme des démonstrations de «volonté d’aller au-delà des restrictionsantérieures », une expression qui résume l’escalade comme une série de tests itératifs des limites. Si la force symbolique échoue, des frappes limitées s’ensuivent. Si celles-ci échouent, l’escalade se poursuit, jusqu’à une « opération de type Just Cause », invoquant explicitement l’invasion du Panama et la capture de Noriega en 1989. La souveraineté dans l’hémisphère est présentée comme révocable sous certaines conditions :
« La récente attaque contre le hors-bord est une démonstration de la volonté du gouvernement américain d’aller au-delà des restrictions antérieures. Les États-Unis disposent d’une série d’options pour aller de l’avant, qui vont de l’évaluation de la suffisance de cette démonstration de force pour amener Maduro à répondre aux préoccupations américaines à des frappes supplémentaires limitées, jusqu’à une opération de type Just Cause visant à traduire Maduro et ses acolytes en justice aux États-Unis, comme cela a été le cas pour Manuel Noriega. »
Dans le même temps, Ellis assure à ses lecteurs qu’aucune occupation à long terme n’est prévue ; les forces rassemblées sont insuffisantes pour assurer un contrôle durable. Cela reflète les contraintes post-Irak et post-Afghanistan, qui imposent des résultats sans implication et un contrôle sans responsabilité. Il anticipe une fragmentation violente, une concurrence criminelle et des sabotages après la destitution du régime, mais les présente comme des externalités à «gérer », et non comme des arguments décisifs contre l’intervention. La responsabilité du chaos est transférée aux acteurs vénézuéliens ou à des « perturbateurs » externes tels que la Russie, la Chine et Cuba. La déstabilisation est à la fois prévue et rejetée.
Ce qui rend Ellis particulièrement important, c’est sa position au sein de l’appareil de défense américain. En tant que professeur de recherche à l’Army War College SSI (Strategic Studies Institute) depuis 2014 et ancien membre du personnel de planification politique du département d’État, il opère à l’interface entre le renseignement, les opérations d’ e et le discours stratégique. Ses analyses s’apparentent davantage à une cognition pré-structurée émergeant de l’écosystème de planification lui-même.
Dans un article parallèle sur la Chine en Amérique latine (intitulé « Preparing for PRC Military Actions in Latin America »), Ellis admet que les activités chinoises en matière de sécurité dans l’hémisphère restent modestes d’un point de vue empirique : dons d’armes, échanges de formation, escales portuaires limitées. Il insiste toutefois sur le fait que pour le Pentagone, ces activités doivent être interprétées « à travers le prisme des menaces qu’elles représentent potentiellement ». La modestie empirique devient alors sans importance ; ce qui compte, c’est le potentiel latent. Les projets commerciaux sont recodés comme étant à double usage, les engagements diplomatiques comme un prépositionnement, les infrastructures civiles comme un futur champ de bataille.
Lues conjointement, ses travaux sur le Venezuela et la Chine illustrent la mentalité sécuritaire : les sociétés sont considérées comme des systèmes à perturber, à stabiliser ou à refuser à leurs rivaux. La démocratie n’est qu’une variable dans cette conception et la souveraineté un statut conditionnel.
Le rapport RAND de 2023 intitulé Great Power Competition and Conflict in Latin America (Compétition et conflit entre grandes puissances en Amérique latine), rédigé pour les forces aériennes et spatiales américaines, le dit clairement : la région est traitée comme une zone arrière stratégique, la politique étant subordonnée aux nécessités militaires. Les tâches principales consistent à soutenir les mandataires, à se préparer à dissuader ou à empêcher l’utilisation des ressources chinoises à double usage dans la région, et à privilégier l’option militaire plutôt que la diplomatie en se préparant à une « demande accrue de ressources de l’armée de l’air américaine sur le théâtre des opérations ».
Ce que montre l’exemple du Venezuela, c’est que l’intensité et la forme de la pression exercée par le bunker sur un État dépendent de sa valeur positionnelle en tant que nœud ou point d’étranglement et de sa distance par rapport aux centres de forces américains. Ainsi, par exemple, le Mexique, Cuba et le Venezuela se trouvent dans l’anneau intérieur du bunker américain ; l’Iran se trouve dans un anneau extérieur où le siège est encore possible, mais plus contesté. Plus le nœud est proche, moins il y a de place pour un développement autonome. Le Venezuela, Cuba et le Mexique sont donc dans une position plus faible, car leur emplacement dans le périmètre de sécurité américain et la stratégie hémisphérique les rendent plus faciles à bloquer, à infiltrer et à punir sans coût cinétique élevé pour Washington. C’est ce qui ressort du document RAND mentionné ci-dessus.
Dans cette zone, la combinaison de la distance (très courte), de la capacité de projection (maximale) et du droit historique (« notre » hémisphère) produit un modèle spécifique de pression que l’Iran ou même la Russie ne connaissent pas de la même manière. En effet, l’Amérique latine fait partie d’une stratégie plus large visant à localiser les chaînes d’approvisionnement dans l’hémisphère, à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et à se préparer à une guerre que les faucons chinois de Washington prévoient ouvertement pour 2030 environ. Ainsi, la pression ne porte pas seulement sur le commerce, mais aussi sur l’alignement du développement national sur les besoins de réarmement des États-Unis. Dans une logique sécuritaire où l’Amérique latine est codée comme zone arrière, la dépendance commerciale renforcera sa vulnérabilité. Dans le cas du Mexique, par exemple, plus ses minéraux, sa logistique et son industrie manufacturière deviendront centraux dans la planification militaire américaine, plus les interventions futures apparaîtront justifiées chaque fois que les choix du Mexique s’écarteront des attentes de Washington.
L’Iran, en revanche, est plus résilient, en partie parce qu’il se trouve à une distance et sur un théâtre différents, qu’il dispose d’outils de dissuasion puissants et qu’il a la possibilité de les développer (par exemple, ses missiles, le détroit d’Ormuz), et qu’il peut se connecter aux réseaux de soutien eurasiatiques par l’intermédiaire de la Russie et de la Chine. Les pays d’Amérique latine ne peuvent pas simplement reproduire ces stratégies, car ils sont sous la domination navale et financière des États-Unis. Néanmoins, la pertinence pour l’Iran est évidente : les méthodes testées dans le bassin des Caraïbes (blocus, décapitation, reconfiguration de l’élite sous pression extérieure) sont désormais adaptées au golfe Persique. L’État bunker exporte son protocole de laboratoire d’un nœud de connectivité multipolaire à un autre.
Les analystes américains et israéliens discutent désormais explicitement de ce modèle vénézuélien comme modèle pour l’Iran. Une analyse de CNN datant de janvier 2026 parlait ouvertement de « décapitation du leadership sans changement de régime » et suggérait que Washington pourrait « prendre le Venezuela comme exemple » lors de la planification des options pour l’Iran. Pendant ce temps, les services de renseignement israéliens ont démontré une portée inégalée à l’intérieur de l’Iran : en juin 2025, lors de l’opération « Rising Lion », le Mossad et les unités alliées ont utilisé des armes prépositionnées et des équipes secrètes pour détruire des lanceurs de missiles et des systèmes de défense aérienne iraniens près de Téhéran, tout en assassinant au moins 14 scientifiques nucléaires et de nombreux commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les enquêtes montrent que le Mossad avait introduit clandestinement des armes de précision et des explosifs en Iran, entretenu des caches pendant des mois, voire des années, et coordonné des équipes au cœur même de Téhéran, tout en échappant à la sécurité iranienne.
Les autorités iraniennes ont annoncé en janvier 2026 qu’elles avaient déjoué de nouveaux plans de sabotage liés au Mossad, qui visaient les infrastructures pétrolières, gazières, électriques et de télécommunications dans plusieurs provinces, preuve que ce réseau clandestin est actif et n’appartient pas au passé. C’est précisément le type d’infrastructure nécessaire à la dégradation secrète et à l’assassinat ciblé de dirigeants pour reproduire une tentative de décapitation à la vénézuélienne contre l’Iran. En conséquence, l’objectif n’est pas une occupation totale, mais plutôt de générer une pression d’usure soutenue, de briser la cohésion de la chaîne de commandement et de forcer un gouvernement résiduel survivant à se « soumettre stratégiquement », c’est-à-dire à accepter le démantèlement des programmes nucléaires et balistiques, à renoncer à sa souveraineté énergétique et à aligner sa politique étrangère sur celle des États-Unis.
L’étranglement lent
Pourquoi cette méthode est-elle préférée ? La stratégie militaire actuelle des États-Unis n’est pas axée sur des guerres décisives et politiquement coûteuses. Elle est conçue pour une gestion permanente des crises et un épuisement permanent. Dans cette logique, le raisonnement suivant s’applique : une guerre ouverte et déclarée contre l’Iran serait risquée, coûteuse et explosive sur le plan intérieur. En revanche, une forme de blocus combinée à des sanctions, des sabotages et des frappes intermittentes est moins coûteuse, plus facile à nier et beaucoup plus flexible.
En effet, dans ce processus d’étranglement lent, la confusion diplomatique fait partie de l’usure. Alors que les envoyés américains peuvent faire miroiter la perspective d’un « accord », la réalité sur le terrain sera celle d’une escalade incessante de la piraterie et de l’interdiction. Cette confusion vise à créer un conflit entre les factions au sein des nations ciblées : une élite « pro-accord » est tentée par de fausses promesses de soulagement, tandis que la réalité militaire sur le terrain (ou en mer) resserre l’étau. La stratégie américaine consiste à utiliser ce brouillard diplomatique pour retarder une réponse unifiée de la Russie, de la Chine et de l’Iran, permettant ainsi à la « guerre en mer » de démanteler leurs routes commerciales petit à petit avant qu’ils ne puissent s’entendre sur une défense navale commune.
Un Iran étranglé saigne la Chine, qui dépend du pétrole iranien et devrait investir de l’argent et du capital politique pour maintenir Téhéran à flot. En outre, cela pourrait affaiblir la Russie, qui doit fournir des armes, de la technologie et une couverture diplomatique pour éviter de perdre un partenaire clé. Cela dissuaderait les pays du Sud de poursuivre des projets indépendants similaires. Enfin, une telle approche fournit un prétexte sans fin à la présence des troupes américaines dans le Golfe, justifiant les budgets et la sécurisation intérieure. Il s’agit d’une stratégie moins risquée et plus rentable qu’une campagne de bombardements spectaculaire, dont les retombées politiques pourraient accélérer le désordre occidental.
La logique du déclencheur : 40 000 soldats comme boucs émissaires
L’un des indicateurs les plus révélateurs du fait qu’il ne s’agit pas d’une désescalade est le dispositif militaire. Il y a encore environ 30 000 à 40 000 soldats américains dispersés dans des bases au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et à Oman, toutes à portée des missiles à courte portée et des drones iraniens. D’un point de vue conventionnel, c’est de la folie : pourquoi laisser autant de forces exposées si l’on craint une escalade ? Du point de vue de la stratégie militaire actuelle des États-Unis, cela pourrait être intentionnel.
Ces troupes servent de déclencheurs. Si l’Iran répond au blocus ou au sabotage par des frappes de missiles sur ces bases, Washington obtient instantanément une légitimité nationale pour mener des opérations massives d’« autodéfense ». Après tout, les élites fonctionnelles transatlantiques sont de plus en plus disposées à tolérer des centaines, voire des milliers de victimes militaires si cela permet de préserver l’architecture plus large de la domination occidentale. Les soldats américains seraient ici utilisés comme des substituts sacrificiels dans le but de geler ou de ralentir la multipolarité.
« Peu de ressources »
On pourrait supposer qu’un engagement militaire relativement modeste et visible, un groupe aéronaval, quelques escadrons supplémentaires, aucune mobilisation massive, ne signale aucune intention sérieuse de confrontation avec l’Iran. Cependant, cette faible empreinte est en soi un indice de la nature de la stratégie : un éventuel blocus économique, ainsi que l’application d’un embargo pétrolier et les mesures d’interception des pétroliers déjà en cours, nécessitent des patrouilles, et non des armadas. Un blocus naval ne nécessite pas six porte-avions. Il suffit d’une présence et d’une puissance de feu suffisantes pour que le transport maritime commercial, les assureurs et les États tiers se plient aux « sanctions » américaines. C’est exactement l’ampleur que nous observons. Le sabotage secret ne coûte rien sur le plan politique, et les équipes de renseignement et les unités cybernétiques qui peuvent nier leur implication n’apparaissent pas sur les images satellites. Les frappes de décapitation nécessitent des forces spéciales, et non des divisions blindées.
Dans l’ensemble, le confinement permanent de la connectivité économique ne nécessite aucune occupation, seulement une menace et une instabilité suffisantes pour rendre les investissements et l’intégration à long terme peu attrayants et risqués. Enfin, sur le plan structurel, le document de Brookings intitulé « Which Path to Persia? » (Quelle voie vers la Perse ?) de 2009 traitait la pression maritime, les sanctions et les frappes aériennes comme des options distinctes parmi lesquelles une puissance hégémonique rationnelle pouvait choisir. Dans la situation actuelle, ces options se sont consolidées en une structure : une posture quasi permanente de navires, de bases et de mécanismes d’embargo autour de nœuds clés (Hormuz, Caraïbes, golfe du Mexique). Le porte-avions USS Abraham Lincoln est présent parce que le gouvernement américain considère désormais que le confinement de l’Iran en mer est une condition par défaut.
En d’autres termes, cette opération américaine n’est pas peu coûteuse en ressources parce que Washington a perdu tout intérêt à déstabiliser l’Iran, mais parce que le mode de guerre choisi est le blocus et la déstabilisation par des actions secrètes. Le fait que les forces américaines soient insuffisantes pour remporter la « victoire » indique que l’objectif est une guerre d’usure continue.
Ce n’est pas une question de politique, mais de structure
Rien de ce qui se passe actuellement n’est conceptuellement « nouveau ». Le document de Brookings intitulé « Which Path to Persia ? » (Quelle voie vers la Perse ?) de 2009 répertoriait déjà les options possibles : sanctions, actions secrètes, guerre par procuration, frappes aériennes et invasion. Bon nombre des outils actuels y figuraient sous forme de plans. Cependant, nous pouvons discerner un changement qualitatif : En 2009, il s’agissait de politiques, de positions parmi un éventail d’options qui étaient sélectionnées, combinées ou écartées en fonction d’un calcul coûts-bénéfices. Au milieu des années 2020, elles se sont transformées en structure. Une fois que la logique anti-entropique est acceptée (« nous devons à tout prix empêcher l’intégration multipolaire »), les sanctions, les blocus et la déstabilisation secrète deviennent des instruments permanents de l’ordre unipolaire en déclin.
L’objectif est donc de maintenir l’Iran dans un état de faiblesse suffisamment longtemps pour qu’il ne puisse pas servir de pont stable entre la Chine, la Russie et les pays du Sud. L’objectif plus fondamental est la dégradation systémique : transformer l’Iran en un espace chroniquement instable, économiquement épuisé et politiquement fragmenté, ce qui n’est pas favorable à la connectivité eurasienne à long terme.
C’est exactement la même logique qui sous-tend la pression maximale exercée sur Cuba et le Venezuela : tous deux sont des ennemis idéologiques et des points d’étranglement géostratégiques ; Cuba à l’entrée du golfe du Mexique, le Venezuela dans le théâtre énergétique des Caraïbes. La destruction de leur souveraineté réduit les options du Mexique, du Brésil et d’autres pays, et renforce l’emprise occidentale sur les voies maritimes et la logistique régionale. Vu sous cet angle, nous assistons à un triage géopolitique brutal mais cohérent, qui consiste à appliquer un désordre contrôlé à des nœuds clés (Iran, Cuba, Venezuela et potentiellement d’autres) avant qu’ils ne puissent se développer pleinement et se connecter à un réseau alternatif.
La confrontation de deux logiques
Tout cela se produit dans un contexte de déclin du pouvoir matériel et symbolique des États-Unis en raison de la désindustrialisation, du surendettement, de la polarisation politique et de la perte de légitimité. Les stratégies militaires émergentes sont le symptôme d’une adaptation à cette faiblesse. La confrontation avec l’Iran est donc le théâtre d’une lutte plus large entre deux principes organisateurs : d’un côté, une logique qui cherche à imposer et à contrôler le maintien de la hiérarchie par la fragmentation et le contrôle coercitif d’autres pays. De l’autre côté se trouve la logique multipolaire, qui menace le statu quo mené par les États-Unis en favorisant la souveraineté par la connectivité et la diversification.
La logique de l’hégémonie déclinante instrumentalise les fractures internes. Comme le souligne l’analyste géopolitique John Helmer, les États-Unis ont adopté une logique « gangster » d’extorsion, utilisant des droits de douane discriminatoires et la guerre physique en mer pour créer une fracture mortelle entre les élites dirigeantes du monde non aligné. Helmer observe que dans toutes les capitales clés – Téhéran, Moscou, Pékin et New Delhi – les États-Unis encouragent activement un schisme entre une faction « business as usual » (oligarques et technocrates désespérés de conclure un accord et de soulager la pression économique) et une faction « résistance » (services militaires et de renseignement qui affirment que toute concession ne fera qu’encourager Washington à monter les enchères). En ciblant individuellement les nations avec des sanctions discriminatoires, les États-Unis visent à rendre le coût du maintien de l’alliance multipolaire plus élevé que le prix de la soumission, pariant essentiellement que les factions favorables à un accord finiront par rompre leurs propres partenariats stratégiques pour sauver leurs économies nationales. Cette guerre hybride est donc une course contre la montre : les factions de résistance pourront-elles consolider les défenses de leur alliance avant que les factions favorables au statu quo ne capitulent face à l’étranglement économique ?
L’Iran réagit déjà dans le cadre de cette logique multipolaire. Il a adopté une doctrine de défense anticipée, signalant sa volonté de frapper les bases américaines et éventuellement de fermer le détroit d’Ormuz s’il était acculé, tout en renforçant ses liens économiques et militaires avec Moscou et Pékin, qui constituent ses bouées de sauvetage face aux sanctions. Les élites au pouvoir aux États-Unis parient qu’elles peuvent infliger suffisamment de dommages à des nœuds clés comme l’Iran assez rapidement pour briser la cohésion de ce réseau émergent avant que leurs propres contradictions internes (fractures sociales, épuisement économique, crise politique) ne les détruisent. La grande inconnue est le point de rupture : pour qui les coûts deviendront-ils insoutenables en premier ?
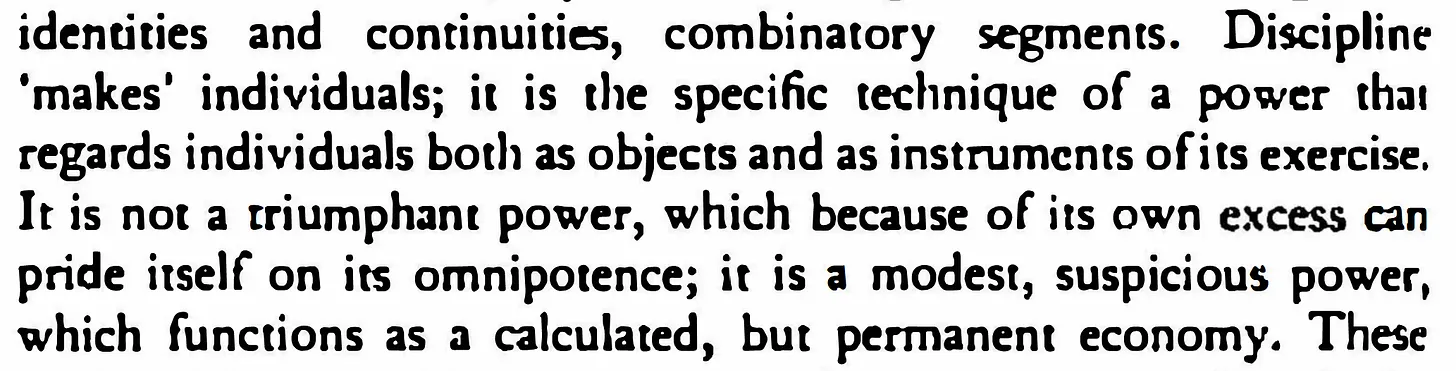
Notes de fin : la guerre a changé de théâtre
Décrire la phase actuelle comme un « retrait » de l’Iran revient à mal interpréter la nature du pouvoir impérial moderne. Il n’est pas nécessaire de recourir à des invasions fracassantes ou à une campagne télévisée de « choc et effroi ». L’hégémon en déclin peut mener et mènera une guerre silencieuse et brutale par l’étranglement économique (sanctions, blocus, exclusion financière), la désintégration (sabotage, assassinats, cyberattaques) et la guerre narrative (cycles de provocation, de réponse et de légitimation qui présentent chaque acte d’autodéfense comme une agression). Et c’est déjà ce qu’il fait. Tout en laissant ouvertement et visiblement sur la table l’option d’actions et d’opérations cinétiques.
Le discours impérial superficiel sur les armes nucléaires, le terrorisme et les droits de l’homme ne fait que masquer ce qui est réellement en jeu. À savoir : la connectivité, que l’Iran représente en tant que pont terrestre eurasien ; le danger de la dédollarisation ; les idéologies étatiques alternatives et les modes d’organisation des sociétés ; et, finalement, un effet de démonstration – la preuve que la résistance contre l’hégémonie américaine peut être couronnée de succès. L’objectif est d’empêcher la consolidation d’un monde multipolaire, et non de parvenir à la paix ou à la stabilité.
Appeler cela une « désescalade » revient à capituler devant la responsabilité d’appeler la guerre par son nom lorsqu’elle est menée par d’autres moyens. Car l’objectif reste la destruction ou la neutralisation de tout pont entre l’Est et l’Ouest, de tout tissu conjonctif fonctionnel d’un ordre multipolaire. La seule chose qui a changé, c’est la forme : des options politiques discrètes à une structure opérationnelle permanente ; des guerres qui commencent et finissent à des guerres qui, officiellement, ne commencent jamais et ne finissent jamais. C’est la guerre d’un ordre hégémonique moribond contre l’infrastructure qui le remplace.
Addendum
Voici les notes qui abordent en partie les sujets discutés ici :
L’illusion du retrait — « Désescalade » avec l’Iran
Sur les minéraux critiques, l’extraction des ressources et l’impérialisme
Les sociétés du cercle intérieur : l’Amérique latine dans la zone de commandement du bunker
Publié initialement en allemand sur NachDenkSeiten (texte et audio).
